- Détails
- Publication : 23 mars 2017

À l'occasion du Salon du livre de Paris, qui se tient jusqu'à lundi, la romancière évoque les écrivains de son pays, qui sont invités d'honneur de cette édition.
Vingt-neuf ans après Tahar Ben Jelloun, la Franco-Marocaine Leïla Slimani a décroché le prix Goncourt pour son second livre, Chanson douce. Le temps d'un entretien, la romancière, sur le point d'accoucher de son deuxième enfant, évoque la littérature de son pays natal, qu'elle n'a découverte qu'arrivée en France pour ses études. Une littérature dont elle décrit la grande diversité et la liberté de ton, tout en pointant sa difficulté à exister.
Slimani a étudié au lycée français de Rabat, et ses parents parlaient français à la maison, si bien qu’elle parle mal l’arabe. Elle a reçu une éducation progressiste. «[Nos parents] nous ont toujours dit, à mes sœurs et à moi, que notre corps nous appartenait, qu’on avait le droit d’en disposer comme on voulait, dit-elle à "Elle". Et, en même temps, qu’on n’avait pas le droit de se promener avec un homme. Allez comprendre.»
Elle juge qu’elle ne pourrait pas être heureuse au Maroc, pays où les femmes, dit-elle, sont «obligées de vivre dans le mensonge perpétuel». «Je ne veux pas avoir peur parce que je porte une jupe dans la rue, parce que je monte seule dans un taxi ou parce que je fume une cigarette pendant le ramadan.» En janvier, elle sortira «Sexe et mensonge», un essai journalistique consacré à la «misère sexuelle dans le Maghreb».
Quand elle était enfant, son père lui lisait «les Mille et une nuits», qui reste pour elle un texte fondateur : «C’est un livre qu’on connaît toujours mal, a-t-elle dit au magazine "Lire". On a tendance à revenir sans cesse aux mêmes histoires et à occulter le reste. Il y a toujours de nouvelles fables à découvrir, de nouvelles significations qui jaillissent selon l’époque, le lieu et l’humeur dans laquelle on le lit.» Ses principales influences: Tchekhov, qui «aime ses personnages» et «ne les juge jamais». Elle aime particulièrement ses nouvelles, «pour leur humanité, pour leur tendresse». Stefan Zweig aussi, qu’elle a aimé à tel point qu’elle a entrepris, à la vingtaine, un pèlerinage zweigien en Europe de l’Est, à Vienne, Prague et Budapest. Milan Kundera, enfin, qu'elle citait en exergue de son premier roman, «Dans le jardin de l'ogre».
Elle a quitté le Maroc à 17 ans, pour entrer en hypokhâgne à Paris, après avoir un temps envisagé de devenir psychiatre. «Cela a été très dur, dit-elle à "Elle". Je ne me rendais pas compte que j’allais connaître une telle solitude. Je me souviens de semaines entières où je ne parlais à personne en dehors des cours. Les Parisiens prennent un café le soir ensemble et, après, chacun rentre dîner chez soi. C’est inimaginable au Maroc, où on invite les gens qu’on sait seuls. Le premier hiver a été interminable, j’ai mis de longues années à me faire des amis.»
Elle a un temps envisagé de faire du cinéma, a collaboré avec une cinéaste marocaine et s’est inscrite au cours Florent, avant de prendre conscience qu’elle était une «comédienne médiocre». Dans une école de commerce, elle fait la connaissance de Christophe Barbier, qui lui propose un stage à «l’Express». Elle devient journaliste, puis entre à «Jeune Afrique». Elle trouve le métier «dur et chronophage». «J’avais toujours l’impression de ne pas en faire assez, dit-elle à "Libération", de ne pas être à la hauteur. Et puis, c’est un métier où l’on ne vieillit pas bien.»
Son mari est banquier. Elle a eu un enfant avec lui en mai 2011. En 2012, elle démissionne de «Jeune Afrique» pour se consacrer à l’écriture, tout en gardant un pied dans le journal comme pigiste. «J’ai su que certains riaient dans mon dos en disant: son mari gagne bien sa vie, cette histoire d’écriture, c’est une manière polie de dire qu’elle est entretenue», a-t-elle déclaré à «l’Obs».
"Mes collègues ne savaient pas que j'écrivais" : pas facile d'être romancier dans une entreprise
L’idée de son premier roman lui est venue en 2011, alors qu’elle s’occupait de son fils en regardant la télévision, alors entièrement occupée par l’affaire DSK. Elle décide de donner vie à un personnage féminin à l’appétit sexuel dément. Elle écrit quelques chapitres, qu’elle fait parvenir à l’éditeur Jean-Marie Laclavetine, qu’elle a rencontré un peu plus tôt pendant un atelier d’écriture organisé chez Gallimard. Laclavetine lui a conseillé de ne jamais s’intéresser à ce que ses personnages pensent, mais à ce qu’ils font. Ces «ateliers de la NRF», lancés en 2012, proposaient 24 heures de cours pour 1500 euros. La maison d’édition précisait qu’«aucun manuscrit ne [devrait] être apporté par les participants en vue d’une publication.»
En 2014, elle sort son roman chez Gallimard, sous le titre «Dans le jardin de l’ogre». L’histoire, assez crue, d’une journaliste paresseuse et nymphomane, qui «hait l’idée de devoir travailler». Le livre mélange fiction et autobiographie de façon troublante. «En l’écrivant, je ne pensais pas que ça serait publié, disait-elle alors à "l’Obs". Quand j’ai su que ça sortirait, j’ai commencé à me demander ce que mes collègues allaient comprendre. Le plus compliqué, c’était de raconter des relations sexuelles à l’intérieur du journal.»
Le roman a beaucoup tourné à «Jeune Afrique». «Beaucoup de blagues, tendres mais pas forcément très fines, sur la vie cachée de Leïla Slimani», témoignait alors un collègue. «Ce qui nous a le plus surpris, dit sa rédactrice en chef, c’est la noirceur du livre. On ne la voyait pas capable d’exprimer un désespoir aussi vif.»
Leïla Slimani : la vie sexuelle d'Adèle R.
Slimani dit être une «grande lectrice de faits divers». Elle a un jour découvert dans la presse l’histoire, aux Etats-Unis, d’une nounou portoricaine qui avait assassiné les enfants qu’elle gardait, et qui n’avait jamais su expliquer son geste. Dans «Chanson douce», aujourd’hui couronné par le prix Goncourt, elle transpose l’affaire à Paris. L’occasion de raconter le rapport de la nouvelle bourgeoisie française à la lutte des classes, de parler de l’opacité de la folie humaine, et de retraiter quelques souvenirs d’enfance:
« J'ai grandi au Maroc, qui est un pays où on a encore des nounous à domicile, mais aussi des gens qui travaillent et vivent chez vous, a-t-elle dit au "Point". Cette façon d'être à la fois des intimes et des étrangers, cette place à l'écart, m'a beaucoup interrogée. Souvent, j'ai assisté à des situations qui m'ont brisé le cœur. Je voulais explorer ce terreau d'humiliation possible, sans dire que c'est une explication possible du meurtre – je n'y crois pas.»

 Version Arabe
Version Arabe








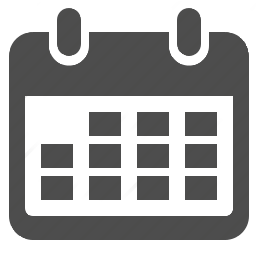 Afficher le mois
Afficher le mois
De plus, Yawatani.com se réserve le droit de supprimer tout commentaire qu'il jurera non approprié.